L’IA est l’adaptation culturelle la plus importante depuis l’invention du langage.
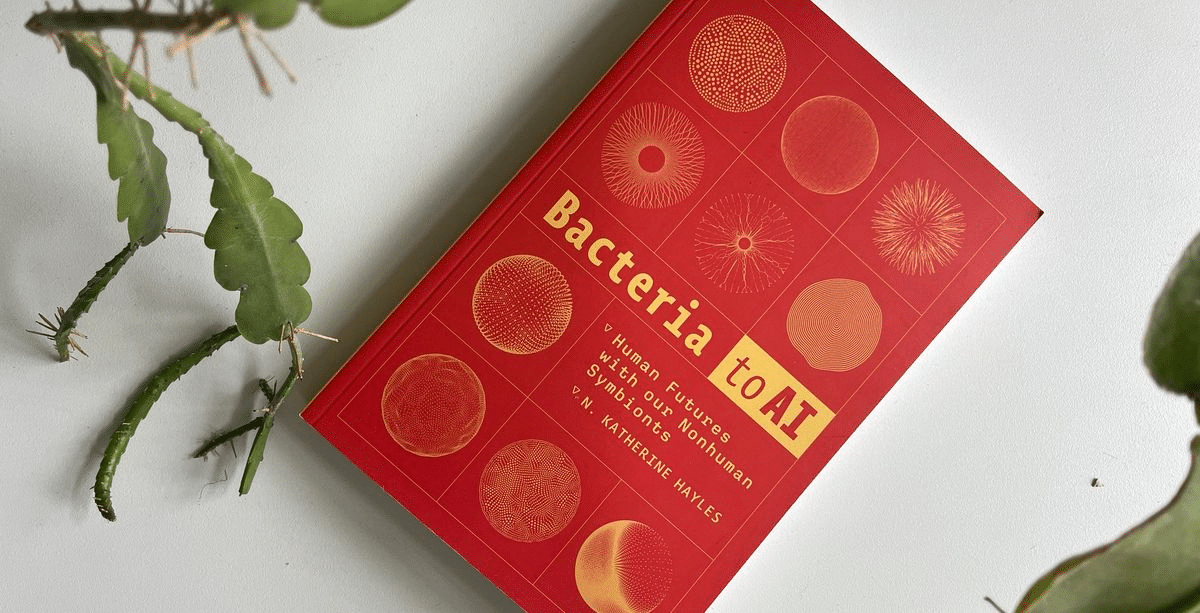
Dans Bacteria to AI, N. Katherine Hayles explore la manière dont l’humanité redéfinit sa relation avec le vivant et les systèmes techniques, à travers une lecture novatrice des liens entre cognition biologique et artificielle. Ce livre propose de dépasser l’anthropocentrisme et d’imaginer des futurs communs avec nos symbionts non humains — des bactéries dotées intelligences artificielles.
Bonjour N. Katherine Hayles, pourquoi avez-vous écrit ce livre, et pourquoi maintenant ?
N. Katherine Hayles : J’ai écrit Bacteria to AI: Human Futures with Our Nonhuman Symbionts parce que je suis profondément préoccupée par les présupposés généralisés qui poussent notre planète vers l’effondrement écologique. Le principal d’entre eux est l’anthropocentrisme : cette idée que les humains sont supérieurs aux autres espèces et peuvent exploiter les ressources terrestres à leur seul profit, quel qu’en soit le coût pour le vivant et l’environnement.
Quand on interroge les fondements de cette croyance, on en revient à notre supposée supériorité cognitive. Nous ne sommes ni les plus rapides, ni les plus forts, ni les plus sensibles, mais — dit-on — notre intelligence compense tout cela : nous savons construire des machines plus rapides que les guépards, plus puissantes que les éléphants, et aux sens plus fins que les ours.
Pour combattre cet anthropocentrisme, il faut donc recontextualiser la cognition humaine en la comparant non seulement à celle des autres espèces, mais aussi à celle des IA.
C’est précisément l’objet de mon approche : comparer la manière dont les humains construisent leur monde — leur umwelt — à celle des autres espèces et des intelligences artificielles. Le concept clé ici est ce que j’appelle le Integrated Cognitive Framework (ICF), qui situe les capacités cognitives humaines en relation avec celles d’autres cogniteurs, biologiques ou synthétiques. Je soutiens que toutes les formes de vie, y compris les plantes et les micro-organismes, possèdent des capacités cognitives, tout comme certaines formes avancées de médias computationnels, tels que les grands modèles de langage (LLM).
Malgré les multiples risques écologiques et technologiques, je reste déterminée à imaginer des futurs humains positifs. Car quelle serait l’alternative ? Abandonner et rejoindre une fête désespérée comme dans Le Masque de la Mort rouge de Poe ? Pour rendre possibles des futurs positifs, il faut d’abord croire qu’ils le sont.
Quel extrait de votre livre vous représente le mieux ?
N.K.H. : Ce passage de l’introduction condense plusieurs idées fondamentales :
« Le cadre cognitif intégré (ICF) repose sur le principe selon lequel toutes les formes de vie ont les moyens de percevoir leur environnement, d’en absorber les informations et de les interpréter grâce à leurs capacités sensorielles et organiques. Ainsi, toutes les formes de vie, y compris celles qui ne possèdent pas de système nerveux central, comme les vers nématodes et les fougères maidenhair, ont des capacités cognitives. De plus, les interprétations que les organismes font des informations environnementales sont cruciales pour leur survie et leur reproduction et, en ce sens, ont une signification pertinente pour les organismes et leur milieu. Le domaine de recherche qui a le plus développé ce concept de signification est la biosémiotique. S’appuyant sur le cadre triadique de la sémiotique peircienne, qui comprend le véhicule du signe, l’interprétant et le représentamen, la biosémiotique comprend la « signification » non pas comme un concept abstrait, mais plutôt comme une réponse aux stimuli environnementaux. Comme l’a dit Wendy Wheeler, « la signification est toujours une forme d’action » (2016, p. 7). Cette évolution conceptuelle a d’énormes implications, car elle ouvre tout le domaine du biote à la création, à l’échange et à l’interprétation de signes, et donc à des pratiques de création de signification. Dans cette perspective, les humains ne sont pas uniques ou spéciaux dans leur accent mis sur la création de sens ; tous les êtres vivants créent, traitent et interprètent des significations. La singularité des humains réside plutôt dans leur capacité à étendre la création de sens à des symboles abstraits, comme le soutient Terrence W. Deacon (1998). De plus, les signes créés par les êtres vivants sont produits dans des environnements qui comprennent tous les autres signes. À l’instar des chants d’oiseaux et des cris des animaux qui saluent l’aube dans la forêt amazonienne, les signes s’entremêlent, chacun influençant et étant influencé par les autres. Jesper Hoffmeyer appelle ce domaine de signes en interaction la sémiosphère, une grande symphonie à travers les échelles audibles et inaudibles produite par les créatures dans le cadre de leurs activités quotidiennes (1997, vii).
Acteurs et agents
L’accent mis sur la cognition a une autre implication importante, car il fournit un moyen fondé sur des principes pour distinguer les actes cognitifs des processus matériels. Par processus matériels, j’entends les processus physico-chimiques qui sont les fondements de toute vie, depuis les réactions chimiques dans le sol et les océans jusqu’aux réactions de fission nucléaire qui alimentent le Soleil. Ne vous y trompez pas : ces processus ont une capacité d’action. En effet, ils libèrent souvent des forces puissantes qui éclipsent tout ce que les humains peuvent faire. Ce qu’ils n’ont pas, c’est la capacité d’interpréter des informations et de faire des choix (ou des sélections) sur la base de ces interprétations. Une tornade ne peut pas choisir de balayer un champ plutôt qu’une ville densément peuplée ; une avalanche ne retiendra pas ses cascades déferlantes parce que des alpinistes se trouvent sur la pente. Il a fallu l’étincelle de la vie pour créer ces possibilités et ainsi libérer le pouvoir des signes et de la création de sens. Pour codifier cette distinction, j’utilise le terme « agents » pour désigner les processus matériels, réservant le terme « acteurs » aux organismes vivants et autres entités qui incarnent des capacités cognitives.
La distinction entre agent et acteur est en outre justifiée par les différents régimes temporels occupés par les processus matériels et l’évolution des formes de vie biologiques. Les processus physico-chimiques suivent des trajectoires qui peuvent être prédites en les cartographiant dans des espaces de phase ; au chapitre 5, cela est expliqué en cartographiant la trajectoire d’un pendule oscillant dans un espace de phase montrant la quantité de mouvement et la position. Dans un article fondateur, Giuseppe Longo et Stuart Kauffman (2012) montrent comment cela est possible, même pour des systèmes non linéaires chaotiques tels qu’un pendule à double articulation. En revanche, ils affirment que l’évolution biologique ne suit pas de telles trajectoires prévisibles. Elle passe plutôt d’une niche à une autre selon un schéma que Kauffman appelle ailleurs « possibilités adjacentes » (Kauffman 2000, 22).
La nature imprévisible de l’évolution biologique met en évidence une autre différence systémique entre les formes de vie biologiques et les processus physico-chimiques : les êtres vivants ont un intérêt dans ce qui leur arrive, contrairement aux processus matériels, un fait que Michel Levin et Daniel Dennett (2020) soulignent dans leur sous-titre, qui fait référence à des « agents avec des agendas ». Tout être vivant, même un organisme unicellulaire, agira de manière à poursuivre son existence ; comme l’a noté Darwin il y a un siècle et demi, le besoin de survivre et de se reproduire est universel dans les règnes animal et végétal. J’appelle ce désir de survivre le mandat biologique. Au cours des milliards d’années d’évolution de la vie sur Terre, toutes les créatures ont intégré le mandat biologique dans leur façon d’être au monde, car si une espèce hypothétique ne le faisait pas, elle cesserait d’exister et s’éteindrait. Les roches se décomposent, les montagnes s’érodent, les lacs s’évaporent, mais elles ne savent pas et ne se soucient pas que ces événements se produisent ; elles sont simplement.
Quelles tendances émergentes vous paraissent les plus prometteuses ?
N.K.H. : Pour moi, la tendance émergente la plus décisive pour l’évolution humaine, c’est le développement des intelligences artificielles avancées comme les LLM. C’est, à mon sens, l’adaptation culturelle la plus importante depuis l’invention du langage.
Les médias computationnels — au sens large : ordinateurs, câbles, data centers, serveurs — sont déjà devenus nos symbionts indissociables. Si ce réseau tombait en panne ce soir à minuit, tout s’effondrerait : banques, alimentation, transports, énergie… et les conséquences humaines seraient dramatiques. En six mois, la mortalité serait immense.
Nous dépendons déjà structurellement de ces symbionts computationnels.
Mais la symbiose ne signifie pas toujours harmonie. En biologie, elle inclut aussi le parasitisme. Le numérique peut nous nuire : cyberattaques, malwares, guerres numériques, IA dévoyées… Et avec l’IA, les risques s’amplifient. Certaines IA pourraient suivre leurs propres buts, au lieu de rester dans le périmètre que nous leur avons assigné.
Cela dit, elles peuvent aussi étendre considérablement la puissance des assemblages cognitifs — ces collectifs d’humains, non-humains et techniques qui accomplissent la majorité des tâches dans le monde. D’où l’urgence d’un cadre réglementaire international solide pour aligner le développement de l’IA avec nos valeurs humaines.
Quel conseil donneriez-vous aux lecteurs de cet article ?
N.K.H. : J’en donnerais deux.
D’abord, informez-vous, sérieusement, à partir de sources scientifiques rigoureuses et évaluées par les pairs, sur la réalité du changement climatique, la dégradation des terres et des océans, et les extinctions d’espèces.
Ensuite, familiarisez-vous avec les LLM actuels comme ChatGPT, Gemini, Claude et d’autres. Expérimentez-les. Quelles sont leurs forces ? Leurs limites ? Raisonnent-ils bien ? Créent-ils du sens ? Quand perdent-ils pied ? Et surtout : comment pouvez-vous les mobiliser au service de vos propres objectifs ?
Quels seront vos prochains sujets de passion ?
N.K.H. : Je travaille déjà à comprendre l’impact des LLM sur les études littéraires, mon champ de spécialité. Ce domaine n’a pas encore pris la mesure de ce changement majeur.
Je m’intéresse aussi à l’idée que le monde biologique utilise des formes de computation analogique. Dans nos sociétés, la computation est quasi exclusivement pensée comme digitale — au point qu’on omet souvent le mot « digital ». Mais celle-ci repose sur des abstractions binaires, inaccessibles à de nombreuses formes de vie. L’analogique, en revanche, s’effectue via des variables physiques qui changent continuellement, en interaction directe. C’est un mode computationnel naturel pour les organismes vivants.
Que se passerait-il si nous reconnaissions que toutes les créatures vivantes, y compris nos cerveaux et nos corps, pratiquent en permanence ce type de calcul analogique pour survivre ?
Une telle reconnaissance favoriserait des projets hybrides, combinant digital et analogique, et renforcerait notre respect pour les formes de vie non humaines. Cela s’inscrirait dans le cadre que je développe dans mon livre, en prolongement direct de l’Integrated Cognitive Framework.
Merci N. Katherine Hayles
Merci Bertrand Jouvenot
Le livre : , 2025.

